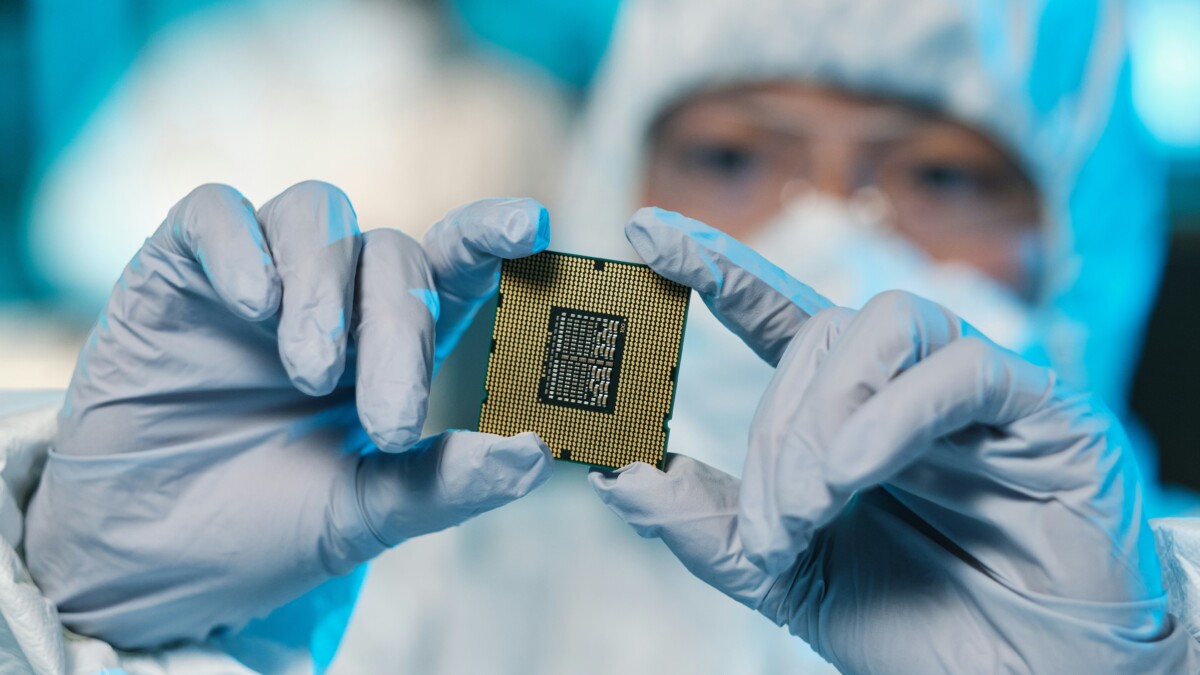Les États-Unis font régulièrement la Une de l’actualité depuis le début du second mandat de Donald Trump. Les projecteurs braqués en ce moment sur les négociations cruciales de la paix entre l’Ukraine et la Russie, ne font pas oublier un autre sujet qui intéresse au premier chef les européens : les décisions du président de la première puissance économique mondiale en matière de droits de douane.
La relation entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis demeure la plus importante au monde en matière de commerce et d’investissements. En 2024, les échanges transatlantiques ont dépassé 1.600 milliards d’euros pour l’ensemble des biens et services. Concernant les biens, l’UE a exporté 532,3 milliards d’euros vers les États-Unis et importé pour 334,8 milliards, soit un excédent de 197,5 milliards d’euros, selon les chiffres publiés par le conseil de l’Europe. Face à cette balance commerciale inégale en matière de biens, le président américain Donald Trump affiche une double motivation : limiter le déficit de son pays et relancer l’industrie sur son propre sol. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a aussi parlé de « rééquilibrage » au moment d’annoncer l’accord de fin juillet 2025, jouant ainsi le jeu du président américain. Cependant, lorsque l’on intègre également les services dans la balance, l’image est moins tranchée : dans ce domaine, en 2024, les États-Unis ont réalisé un excédent de 148 milliards d’euros dans leurs échanges avec l’UE. En clair : l’excédent européen en biens est en partie compensé par l’excédent américain en services, ce qui relativise la thèse d’un déséquilibre massif, où, finalement, le déficit américain n’est que de 50 milliards d’euros, équivalent à 3% des échanges totaux avec son partenaire européen.
Apaisement au prix d’un compromis à sens unique
L’accord du 27 juillet 2025, qui a pris effet le 7 août, fixe un taux plafond de 15% de droits de douane sur la très grande majorité des exportations européennes vers les États-Unis.
Sont notamment concernés les automobiles et leurs pièces (initialement visées par un taux de 27,5%), ainsi que les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs. Une liste conjointe de produits stratégiques à droit zéro doit être précisée, elle inclura l’aéronautique, diverses matières premières, certains produits chimiques et médicaments. Pour d’autres secteurs comme les vins et spiritueux, on attend toujours des éclaircissements.

Toutefois, l’acier et l’aluminium sont exclus de ce plafond. Sur ces produits, les droits qui ont été portés à 50% début juin demeurent en vigueur pour les exportations européennes, avec la perspective, encore à l’étude, d’un système de quotas et d’une éventuelle « alliance des métaux ».
L’accord du 27 juillet inclut aussi des engagements : l’UE devra acheter pour l’équivalent de 750 milliards de dollars d’énergie américaine à l’horizon 2028. Il prévoit également 600 milliards de dollars de nouveaux investissements aux États-Unis par des entreprises européennes, pendant le mandat en cours. Ces montants, célébrés par Washington, nourrissent des critiques en Europe sur l’asymétrie de l’accord : l’UE paie un tarif de 15% et s’engage sur des achats et placements massifs, sans contreparties tarifaires équivalentes pour l’accès au marché européen.
L’accord a bien un (moindre) mérite : celui de rétablir de la stabilité et de la visibilité pour les citoyens et les entreprises, et de réduire l’incertitude qui bloquait les décisions d’investissements. La perspective d’une taxe à 15% est jugée moins dommageable que les 30% envisagés précédemment, mais reste toutefois une mauvaise nouvelle pour l’économie européenne.
Effets économiques incertains
Au-delà de la visibilité accrue pour le monde des affaires, les analyses des précédentes hausses tarifaires, notamment celles de 2018-2019, montrent des effets diffus et souvent coûteux pour le pays qui les impose. D’une part, elles entraînent un recul marqué des importations et des exportations. D’autre part, les prix à l’import des produits taxés ont tendance à augmenter, ce qui signifie que les droits de douane sont largement répercutés sur les prix de vente aux consommateurs et entreprises américaines. Plus récemment, Goldman Sachs a estimé que jusqu’au mois de juin, le coût des droits de douanes était supporté à 64% par les entreprises américaines et à 22% par les consommateurs du pays, et seulement à 14% par les entreprises étrangères. La banque explique qu’après juin, ce seront les consommateurs américains qui absorberont les 2 tiers des tarifs douaniers.
Quant à la compétitivité des entreprises européennes, celle-ci sera directement impactée, notamment dans les secteurs les plus concernés par les exportations (automobile, sidérurgie, chimie). Cette perte de compétitivité-prix sera d’autant plus marquée qu’elle cumule l’effet des droits de douane avec celui d’un euro fort qui renchérit mécaniquement les prix à l’export.
Par ailleurs, les engagements d’achat d’énergie américaine supposent un triplement des volumes importés par rapport aux volumes actuels. Les 600 milliards d’investissements promis, en grande partie de projets en cours, déplaceront de la demande et du capital au détriment d’investissements en Europe, ralentissant alors les objectifs de souveraineté et de compétitivité de l’Europe.
Luxembourg-États-Unis : faibles volumes d’échanges et place financière clé
Les exportations à destination des États-Unis ne représentent que 3% des exportations totales de biens du Luxembourg, selon une note conjoncturelle du STATEC de juin 2025. L’économie luxembourgeois est donc faiblement exposée aux droits de douanes américains, à l’exception de certains secteurs touchés fortement par cette hausse comme ceux de l’acier et de l’aluminium. C’est dans le secteur des services (non soumis à droits de douane) et surtout via l’investissement – Investissements Directs Etrangers (IDE), fonds et holdings – que se joue l’essentiel de la relation économique entre les deux pays. Les IDE américains au Luxembourg atteignaient 569,6 milliards de dollars fin 2024, faisant du Grand-Duché l’un des principaux points d’ancrage des groupes américains en Europe. Pour les acteurs luxembourgeois, l’enjeu est donc la prévisibilité réglementaire et tarifaire qui conditionne les décisions d’implantation et de financement.
À court terme l’accord du 27 juillet offre donc un répit et de la visibilité, mais l’Europe doit maintenant se renforcer, réduire ses dépendances et élargir ses partenariats commerciaux pour moins subir les potentiels bras de fer du futur.
La Chambre de Commerce organise prochainement deux événements en lien avec le marché américain :
- Mission économique à Austin et San Francisco, du 6 au 11 octobre 2025 . Inscriptions avant le 8 septembre 2025 .
- Visite accompagnée au salon international CES de Las Vegas, du 5 au 9 janvier 2026 . Inscriptions avant le 8 décembre 2025 .